
Infirmière « Covid » à l’hôpital

Je suis infirmière. Habituellement, je ne travaille pas dans cet hôpital. Mais il y a eu une grande campagne, des appels aux professionnel·le·s de la santé, disant qu’ils cherchaient du monde et que nous pouvions postuler. J’ai passé une espèce d’entretien « éclair » : on m’a demandé mon métier, mon diplôme, mon parcours et une petite question clinique. J’ai bien répondu à celle-ci et j’ai été engagée. J’ai commencé peu de jours après. C’était assez rapide.
Témoignage recueilli par téléphone en avril 2020.
« Là, il n’était pas question de rentabilité. Là, c’était le service public. Et ça s’est ressenti. »
J’ai travaillé aux soins intermédiaires Covid ; un service de soins aigus, très hospitalier, juste avant les soins intensifs. Un service pour les gens hospitalisés qui ont besoin d’être soutenus dans leur maladie, qui ont besoin d’une assistance pour passer le cap. Après, il y a ceux dont on parle beaucoup, qui sont aux soins intensifs. Elles et ils sont mis dans le coma et, en gros, les machines prennent le relais pour que leur corps fonctionne, le temps de se remettre du Coronavirus. Et moi, j’étais à la croisée des deux, dans un service qui reçoit des patient·e·s dont l’état stable se détériore. Certaines personnes supportent mieux le Coronavirus, car leur système immunitaire arrive à le combattre. Mais quand une personne souffre d’une forme qui dégénère, ça va super vite, elle est anéantie en quelques heures.
Le but du service où j’ai travaillé, c’est de ralentir la péjoration et d’éviter au maximum l’intubation. L’intubation, c’est rude pour le corps. Quand on intube des gens attaqués aussi fortement par une maladie, ce n’est pas évident. C’est un acte invasif, les gens sont dans le coma, sédatés. On essaie d’éviter cela. Parce qu’il y a des complications liées à l’intubation, par exemple, des risques de surinfection hospitalière. Parce que pour les patient·e·s, moins elles et ils subissent d’actes invasifs, mieux c’est. Et aussi parce que la survie est directement liée au nombre de lits. Si on arrive à retenir et empêcher la dégradation chez certain·e·s, il reste plus de lits aux soins intensifs pour d’autres cas graves.
« Elle a monté en deux semaines un service de soins intermédiaires. »
Le service dans lequel j’ai travaillé n’existait pas avant. Une collègue a été appelée le samedi pour commencer le lundi. Elle m’a raconté que son premier jour a consisté à installer le service. Elles et ils étaient 50, une fourmilière incroyable. Il n’y avait pas de lits, pas de matériel. C’était un étage de bureaux. Cette équipe a transformé ce service en deux semaines alors que, en temps normal, ça aurait pris un an. Elle a monté en deux semaines un service de soins intermédiaires avec un équipement important réquisitionné de partout. Tout l’hôpital a fermé ses services non-indispensables. On héritait d’un appareil pour prendre la tension qui venait de la pédiatrie, une pompe du service de chirurgie digestive, un lit de la chirurgie de la main… un gros puzzle. Le premier jour, le personnel soignant a reçu aussi toute la pharmacie ; il a dû l’installer dans les armoires et construire une logique qui ait du sens. En même temps, les informaticien·ne·s s’occupaient des ordinateurs et les électricien·ne·s des lits. Et cette nuit-là, les professionnel·le·s ont accueilli les premier·e·s patient·e·s dans le service !
Au début, l’effervescence était très forte. Nous étions une centaine de soignant·e·s, infirmièr·e·s et aide-soignant·e·s, à être engagé·e·s. J’ai été engagée comme intérimaire. Nous avons reçu des formations dès le départ sur comment s’habiller, comment se déshabiller, comment manipuler et surtout, nous avons été formé·e·s aux soins. Parce qu’en fait, ce sont des soins assez spécifiques, assez aigus. Nous avons suivi des formations express où on nous expliquait le concept. Ça a été bouillant. Au début, tout était de la découverte, de l’ajustement, de la construction, de l’élaboration. Pour moi, cette effervescence était ambivalente. D’un côté, j’agissais, je participais à un effort collectif. D’un autre, je doutais de mes capacités, j’avais peur d’être dangereuse parce que j’aurais offert une mauvaise prise en soin. Je pensais que quelqu’un de plus expérimenté à ces gestes et à ces soins saurait mieux aider les patient·e·s que moi. C’était assez stressant au début.
« Manipuler des gens qui ne sont pas en très bon état demande quand même un savoir-faire, c’est un métier. »
L’armée est aussi venue nous aider. Nous avions donc des gars de l’armée dans le service avec nous. Ce n’était pas de leur faute, mais ils nous prenaient du temps. C’était l’armée sanitaire. Ils nous ont raconté que, durant un week-end ou une semaine, ils avaient été formés à poser des cathéters et à faire des prises de sang. Mais ils pouvaient être danseurs, avocats, fleuristes ; des métiers n’ayant aucun lien avec le domaine de la santé, sans autre expérience que ces quelques jours de formation. Comme pour les astreints de la protection civile, ils étaient réquisitionnés par l’armée.
Le matin à l’hôpital, régnait une ambiance assez spéciale. À l’entrée, les agents de la protection civile contrôlaient ton badge. Les camions de l’armée arrivaient et lâchaient 80 militaires dans le bâtiment, habillés en kaki et en bottes noires. Ils se changeaient dans les WC et dans les couloirs. Une ambiance particulière. Une fois changés, ils étaient habillés comme nous et participaient aux soins comme aides-soignants. Sur leur badge, je crois qu’il était écrit « renfort ». Ils ont été envoyés dans différents endroits, notamment dans notre service, où nous manquions de monde.
Pour que vous compreniez, il faut que j’explique comment fonctionnait le service. Il y avait des salles « propres », le couloir et le bureau infirmier, et des salles « sales », les chambres de patient·e·s. Tout ce qui entrait dans ces salles-là restait dedans, rien ne pouvait en sortir, pas même une feuille ou un stylo ; les ordinateurs également. Nous, nous étions habillé·e·s avec des sur-blouses, des gants, de quoi nous protéger les cheveux, nous avions des lunettes et des masques hermétiques. Tu ne ressortais pas de la salle pendant un moment. Nous faisions des rotations. Tu rentrais avec les traitements de ta première tournée. Pour le reste, si tu avais besoin de faire des soins, de poser des sondes, d’administrer des traitements, ou de quoi que ce soit d’autres, tu ne sortais pas de la salle, tu demandais à des personnes dans la zone « propre » de t’amener le matériel nécessaire. Chaque infirmier·e prenait soin de deux patient·e·s. Puis c’est passé à un·e patient·e, ce qui occupait déjà beaucoup.
Les gars de l’armée, très virils, du genre « on fait partie de l’armée, on a été réquisitionnés, on va au front », étaient très très motivés à aider. Mais ils n’avaient pas du tout de formation. Du coup, nous avons essayé de les mettre à l’endroit où ils devaient t’amener du matériel. Tu étais en salle, et eux dans la zone « propre » ; leur job était d’aller chercher du matériel et de l’amener. Quelques fois, j’avais besoin de quelque chose rapidement, il fallait que ça bouge. Et en fait, le soldat ne savait pas ce que c’était. Tu parles une autre langue que lui. Tu lui demandes : « Va me chercher un set de sondage stp. » Il y va, mais passe 10 minutes à chercher le set. Après, ils sont venus aider pour faire la toilette des patient·e·s, donc ils se sont habillés en intégral Covid. Mais, manipuler des gens qui ne sont pas en très bon état demande quand même un savoir-faire, c’est un métier. Nous nous sommes retrouvé·e·s à devoir les coacher ; ce n’était pas terrible pour l’efficacité, de devoir dire : « non, ne touche pas », « non, ne fait pas ça », « non, ça, ça va contaminer l’hôpital… ». C’était chouette d’avoir une paire de main supplémentaire pour retourner un patient de 90 kg, mais en même temps, tu devais avoir des yeux sur ton patient, qui n’était pas en bon état, et sur le gars qui était là pour t’aider… parfois, ça aidait un peu moins.
« C’était très formateur, mais pas du tout dans le sens habituel. »
Tout s’est fait en accéléré. Tu te formes beaucoup en demandant aux collègues qu’elles te checkent quand tu pratiques les gestes ou les soins. Quand une infirmière débute, d’habitude, elle est doublée pendant quelques semaines. Là, elle devait être autonome en trois jours. Les novices sollicitaient les plus expérimenté·e·s, mais devaient être indépendant·e·s. Ça allait très vite qu’un·e patient·e décompense, alors pendant qu’une collègue s’occupait d’un·e patient·e, l’infirmière novice devait être capable de poser une sonde, etc.
C’était très formateur, mais pas du tout dans le sens habituel. Dans un hôpital universitaire, tu fais en sorte d’apprendre et d’enseigner. Là, on expliquait aux novices si elles en avaient besoin, mais elles n’étaient pas là pour apprendre. Une collègue tout juste diplômée venait plus tôt faire le tour de choses qu’elle n’avait pas encore pratiquées, comme par exemple les cathéters artériels qu’elle n’avait utilisés qu’une fois, à l’école. Ou les trachéos – le tube dans la gorge pour respirer. Ces gestes qui, mal faits, peuvent être très dangereux. Elle venait en avance chaque jour avec ses notes de cours, pour réviser les gestes sur lesquels elle pouvait tomber, une sorte de révision express. Puis, elle nous demandait aussi de l’aide. Très vite, l’hôpital a monté un important module de formation en ligne. Il proposait une révision des soins auxquels les infirmier·e·s allaient être confrontées. Il fallait pour tou·te·s comprendre comment le Covid fonctionnait. Ça a été beaucoup d’apprentissage, mais pas dans le sens traditionnel de l’hôpital universitaire.
« C’était tellement plus bienveillant que d’habitude. »
En comparant avec d’autres expériences vécues à l’hôpital, les relations étaient différentes. Au début, j’étais inquiète de la collaboration entre des soignant·e·s provenant de différents services, ayant été fermés par l’hôpital. J’avais peur de ce mélange entre des expert·e·s et des personnes beaucoup moins expérimentées. Des infirmier·e·s de pédiatrie à la retraite depuis 10 ans étaient même revenu·e·s. Cette crainte des tensions était aussi liée à cette situation stressante, parce qu’on baignait quand même dans le Covid toute la journée.
Et en fait, pas du tout. C’était tellement plus bienveillant que d’habitude. Nous étions plusieurs collègues à savoir pourquoi nous avions quitté l’hôpital, souvent à cause des relations dans les services. En effet, beaucoup de situations font appel à l’éthique de chacun·e et à sa manière de considérer le monde, au sujet de la prise en soins et de comment prendre en compte le contexte social des patient·e·s, dans une relation de pouvoir. Assez vite dans les soins, on peut avoir des désaccords sur des manières de travailler ; des trucs qui touchent à des convictions très personnelles, qui nous définissent. On peut vite te juger, selon comment tu travailles. J’avais un peu de mal avec ces ambiances de cancans, de rapports à la différence dans un monde où tout est normé. On doit entrer dans des protocoles et on se retrouve dans le jugement et la soumission à la hiérarchie. Dans l’institution hospitalière, qui est une entreprise, qu’on se le dise, toi tu es une petite fourmi qui doit, par ta performance, participer à sa bonne marche. Et les petites fourmis se font la guerre.
Par le passé, j’ai trouvé dure la vie de l’entreprise hospitalière. Mais là, il y avait vraiment un énorme changement. Tout le monde se rappelait pourquoi il faisait ce métier, pourquoi il était dans les soins. Nous nous serrions les coudes. Nous étions tou·te·s dans la même merde. Personne ne savait faire ça. Personne n’avait jamais été formé à prendre en charge les cas d’une épidémie. Nous allions y arriver. Chacun·e allait partager ses connaissances. Des collègues étaient calé·e·s en technique, d’autres avaient des connaissances du réseau pour accompagner les gens qui sortent après avoir guéri du Covid. Nous utilisions les compétences de chacun·e, plutôt que le truc habituel de se tirer dans les pattes, si tu ne remplis pas les critères. Nous étions vraiment tou·te·s ensemble pour faire en sorte que les gens aillent mieux. J’ai trouvé cette entraide hyper agréable et stimulante : exploiter au mieux les connaissances, les particularités et les individualités de chacun·e, plutôt que de rentrer dans le moule de la performance hospitalière. J’ai observé qu’il y avait beaucoup moins d’enjeux de savoir, de se montrer. Tout le monde se mettait assez vite où il fallait. Un tel disait : je m’occupe des poubelles, etc. Il n’y avait plus de tâches ingrates.
« Les chef·fe·s ont plutôt organisé l’aspect qualité du travail. »
D’habitude dans un service, il y a plusieurs unités et chacune a son équipe et son chef·fe d’équipe. Ce·tte dernier·e te connaît, elle ou il est au quotidien avec toi dans ton travail. C’est ta ou ton responsable direct·e, la personne référente dont dépendent beaucoup de choses. Une bonne ou une mauvaise entente va se répercuter sur tes congés, tes possibilités de formations ou de changement de service. Donc, tu as plutôt intérêt à bien t’entendre avec ta ou ton chef·fe. Alors que là, nous ressentions moins cet aspect hypocrite, noyé dans la masse. Nous travaillions dans un service qui n’existait pas auparavant. On nous a attribué plusieurs chef·fe·s, entièrement voué·e·s à la logistique. Elles et ils ont monté un service de soins de A à Z ! Elles et ils étaient dans des questions de matériel et de flux et peu avec nous.
Nous subissions beaucoup moins de rapports hiérarchiques et ça avait un impact direct sur notre qualité de vie au travail. En l’occurrence, les chef·fe·s servaient de support logistique, que nous pouvions solliciter pour améliorer nos conditions de travail. Ils s’assuraient que nous étions suffisamment doté·e·s en personnel, que la charge de travail était gérable pour tenir sur la durée. Elles et ils ont fait venir plein d’expert·e·s qui passaient régulièrement nous demander si nous avions besoin d’aide ou des questions, si elles et ils pouvaient nous apprendre des choses. Les chef·fe·s ont organisé l’aspect qualitatif du travail. D’habitude, tu as plutôt un rapport inverse où ils te rendent facilement la vie impossible. Là, nous n’avions pas du tout ce rapport. Aussi parce que nous étions beaucoup moins en contact. D’habitude, elles et ils gèrent une équipe et là, les chef·fe·s ont géré un service. Ça change pas mal.
« La prise en charge était très globale. »
Avec les médecins, nous avions déjà amorcé un virage quelques années auparavant. Nous sommes une nouvelle génération. Les médecins internes, encore plus spécifiquement dans des soins aigus, elles et ils nous posent des questions. C’est intégré que nous ne faisons pas le même métier, mais les médecins n’imposent pas leurs décisions. Nous réfléchissons ensemble et participons à l’élaboration commune de la prise en soin.
Avec le Covid, il y a eu davantage d’échanges. Les médecins expliquaient leur compréhension de la situation. Mais on ne connaît pas ce virus et ne comprend pas plein de ses symptômes. On ne sait pas pourquoi ça se passe, d’où ça vient, et combien de temps ça va durer, ni ce qu’on peut faire ou pas. On est dans une forme de médecine « pansement » où l’on essaie de gérer les symptômes, d’empêcher la péjoration. Les patient·e·s sont tout le temps sur le fil, en équilibre, et peuvent basculer d’un coté comme de l’autre. On fait de l’équilibrisme en essayant de gérer les symptômes, pour que les patient·e·s basculent plutôt du bon coté que du mauvais. Et je pense qu’un lien se crée avec les médecins, qui ne sont pas autant démuni·e·s que nous, mais presque. De toute façon, personne ne connaît rien à ce virus, que ce soit les médecins ou les infirmier·e·s. Ce n’est pas comme si l’un·e avait pu l’étudier et en savait plus que l’autre. Chacun·e, avec les spécificités de son métier, observe ce qui se passe chez les patient·e·s et, ensemble, nous concoctons quelque chose. Les médecins décident quand même à la fin, mais de manière un peu différente que d’habitude.
Nous interagissions beaucoup avec les physiothérapeutes « respiratoires » qui nous aidaient à gérer les machines qui ont des milliards de paramètres. Heureusement qu’elles et ils étaient là, elles et ils nous sauvaient la vie. Ces physiothérapeutes s’occupaient de la partie appareillage et nous, nous surveillions comment cela s’imbriquait dans le quotidien des patient·e·s. Nous les côtoyions beaucoup plus que d’habitude où, dans les services de réhabilitation, c’est très schématisé : le physio vient, prend la patiente et va marcher avec, puis la ramène dans l’unité. Alors que là, comme les patient·e·s restaient dans la salle et les physiothérapeutes avec, nous pouvions participer davantage à cette prise en charge, aider à faire des exercices d’équilibre, partager comment la patiente se mobilisait après les soins d’hygiène. Nous étions là pour les physiothérapeutes, les logothérapeutes, les neurologues, les radiologues, pour tou·te·s les intervenant·e·s. Nous étions là, nous interagissions. La prise en charge était globale.
Dans la salle, nous nous relayions, parce que les masques font super mal. Les masques hermétiques te scient le visage, qu’on se le dise ! L’arête du nez, les oreilles et les pommettes prennent cher ! Nous organisions les pauses suivant la charge de travail, mais environ toutes les trois heures. Le matin, nous entrions tou·te·s dans la salle parce que nous avions la prise en soin de nos patient·e·s. Puis certain·e·s restaient dedans et nous nous relayions. La nuit, nous étions autant d’infirmier·e·s que le jour. Si ça allait mal, tout le personnel présent se mobilisait très vite. Nous étions au départ d’une ligne de dominos. Nous essayions d’empêcher les patients de sombrer. Ça pouvait aller super vite. Quand ça se mettait à aller mal, ça allait super mal. Nous n’avions pas le temps de faire grand-chose. Nous devions les emmener aux soins intensifs pour les intuber.
« Nous n’avons pas eu à nous poser la question du choix des patient·e·s que nous soignions. »
En Suisse, les hôpitaux ont des moyens. Tout le monde a son lit, son respirateur. C’est une situation assez rare en Europe ! La menace de mort n’est pas aussi directe que dans d’autres pays, parce qu’on a les moyens de ventilation. Dans d’autres pays, les patient·e·s ont soit les lunettes à oxygène, fixées dans le nez et reliées au mur, tout simple, soit l’intubation et souvent, il n’y a rien entre les deux. Pas de moyens intermédiaires. Ici, le luxe, c’est toute une gamme intermédiaire de moyens de ventiler les gens pour pas qu’elles et ils soient intubé·e·s. On a pas mal de technologie, c’est assez impressionnant. Et en nombre. Et pour tout le monde. Nous n’avons pas eu à nous poser la question du choix des patient·e·s que nous soignions. Nous avons eu des questionnements éthiques qui se posent de toute façon dans les soins, pas uniquement en période de Covid où on a envie de sauver tout le monde. Reste quand même la question qui se pose dans certaines situations : est-ce de l’acharnement thérapeutique ou pas ?
La mort, dans les soins, fait partie du métier. Je ne trouve pas que nous ayons plus été confronté·e·s à la mort que d’habitude. Sûrement parce que nous avions pas mal de moyens. Ce qui changeait, c’était l’accompagnement que nous faisions d’habitude et là pas. L’absence des familles. Nous-mêmes, les patient·e·s ne nous voyaient pas. Elles et ils ne voyaient ni nos sourires ni nos yeux, ne voyaient rien du tout. Ça transformait beaucoup les soins. Durant cette période, notre rapport avec les patient·e·s que nous suivions jusqu’à la mort a complètement changé ; nous les accompagnions de manière extrêmement différente. Après, les patient·e·s meurent, mais cela fait partie du métier. Particulièrement en Suisse, je n’ai pas entendu parler de morts auxquelles on ne s’attendait pas. C’étaient des attaques virales très fortes ; nous faisions tout ce que nous pouvions, mais nous voyions venir l’échec. Nous n’avons pas eu un rapport à l’incontrôlable, à l’injuste.
Je ne sais pas trop comment la presse parle de l’état neurologique et cognitifs des patient·e·s qui sortent des soins intensifs, parce que j’ai arrêté de suivre ce qu’on en disait de l’extérieur. Ce que j’en voyais par moi-même me suffisait. On les remontait dans notre service, dans l’optique de garder un maximum de lits de soins intensifs disponibles, mais ces patient·e·s n’étaient pas vraiment là. C’est fantastique que ces personnes survivent au Covid, sauf qu’elles ne savent plus comment elles s’appellent. Elles ne sont plus capables de parler. Elles vont probablement toutes suivre une rééducation pendant quelques mois. Elles survivent, mais dans quel état ! Tu essaies de créer un contact avec des personnes complètement perdues. Dans le meilleur des cas, elles sont confuses sur où elles sont. Tu fais un soin et elles te demandent s’il y a du lait dans le frigo… Le pire, ce sont celles qui ne parlent pas, un peu comme si elles avaient fait un AVC. Certain·e·s patient·e·s récupèrent progressivement, mais ça dure longtemps pour bien plus de la moitié. Leur état s’améliore super lentement.
« La famille vient et complique la prise en charge effective du pion hospitalier qui fait marcher l’entreprise. »
Les visites ont été interdites à l’hôpital, même lorsque des personnes mouraient. Une équipe s’est organisée avec des ipad et l’application zoom. Les familles prenaient rendez-vous avec l’équipe qui amenait l’ipad aux patient·e·s pour qu’elles et ils puissent quand même avoir des échanges et les voir. Les familles pouvaient laisser des objets à l’accueil en bas de l’hôpital. Sur des paravents entre les lits, nous collions des photos de proches pour recréer un espace ressemblant à un entourage affectif. Nous essayions de palier cette absence comme ça.
Pour nous, très cyniquement, sans les familles, c’était quand même moins de soucis. Dans les soins, parfois les familles peuvent être hyper exigeantes, hyper demandeuses, hyper lourdes à gérer. Nous devons nous occuper de la patiente et en plus gérer sa famille, avec de nombreuses contraintes. Ne pas avoir les familles libère de l’espace mental. Nous interagissions au téléphone, mais de manière cadrée. Très vite, l’hôpital a mis en place des lignes téléphoniques où les proches pouvaient appeler pour avoir des nouvelles, mais seulement une ou deux fois dans la journée.
En tant que soignant·e·s, tu as tes médicaments, ta radiographie ; si le patient n’est pas là, la radio repart et tu attends trois heures. Nous avons des contraintes qui ne sont pas du tout humaines, mais liées à la performance du métier : des tâches que tu dois accomplir durant ton shift. La famille vient et complique la prise en charge effective du pion hospitalier qui fait marcher l’entreprise. Les familles ne sont pas là, et c’est malheureusement plus « confortable », car elles sont parfois un peu des « grains de sables » dans les rouages de la prise en charge.
Émotionnellement, la famille a un gros impact sur les patient·e·s. Même si tu veux que la machine fonctionne, ton but est que les patient·e·s guérissent. Et nous voyions que, après avoir eu des interactions avec leurs proches sur zoom, elles et ils allaient tellement mieux et tout à coup rigolaient ! Ça avait un fort impact sur leur humeur et leur motivation, sur le fait que les patient·e·s retrouvent des forces ou se laissent aller. J’ai passé une demi-heure où j’ai juste tenu un téléphone en face de quelqu’un, sans parler car je ne comprenais pas sa langue. Ce patient n’avait pas la force de tenir le téléphone. En fait, nous passions du temps à contacter la famille, mais ne l’avions pas avec nous. Nous choisissions quand avaient lieu ces interactions. Ce patient avait passé tous ses examens ; nous ne risquions pas d’interrompre la communication. Nous pouvions planifier les moments de soutien moral et psychologique. C’est horrible à dire, humainement et éthiquement. C’est l’industrie hospitalière.
« Le côté stressant, c’est que tout repose uniquement sur ta discipline personnelle. »
Quand je suis arrivée le premier jour à l’hôpital, je ne savais pas du tout quelle était l’ambiance. J’avais eu des échos de comment ça se passait en France. Du coup, je voulais bien aller travailler dans un service Covid, mais pas sans équipement. Quand je suis arrivée, j’ai vu que le maximum avait été mis en place pour nous protéger et je me suis sentie rassurée. Je connaissais les gestes, je savais à quel moment me désinfecter les mains, à quel moment mettre mon masque et l’enlever. Nous avons suivi une formation sur comment nous équiper. Je me suis dit : institutionnellement, tout est fait pour que nous prenions le moins de risque possible. Le côté stressant, c’est de te reposer uniquement sur ta discipline personnelle. Ne pas oublier à chaque fois que tu touches ton masque, de te laver les mains. Se toucher le visage, d’habitude on le fait toutes les 30 secondes, sauf qu’à l’hôpital, on baigne dans le Covid. Le Covid est partout. Tu touches quelque chose puis tu touches ton visage, tu t’auto-inocules.
C’est aussi une histoire de responsabilité collective : s’il y en a un qui fait l’erreur de sortir quelque chose d’une zone « sale » et de le mettre en zone « propre », par exemple un stylo sur lequel le patient a toussé ; toi, tu ne te méfies pas, tu le prends, tu as le réflexe de le mettre à la bouche, ça va hyper vite. Au départ, l’organisation institutionnelle, c’est un peu un soulagement, puis tu te dis : « oh mon dieu, c’est sûr qu’à un moment je vais faire une erreur ! » Et en travaillant 12 heures d’affilée, après 10 heures, ton cerveau ne fonctionne plus de la même manière. J’ai pensé que je l’attraperais et espéré que, n’ayant pas de facteur de risque, ça passerait. Après un mois à l’hôpital, les professionnel·le·s ont peut-être plus tendance à banaliser le danger. Avec la banalisation, vient le risque d’erreur.
« La métaphore des héros et des héroïnes ne me parle pas du tout ! »
À l’extérieur de l’hôpital, j’ai vécu toutes les interactions possibles et imaginables. Des gens ne voulaient pas me voir parce que j’étais infirmière Covid. D’autres n’en avaient rien à cirer. D’autres encore étaient hyper admiratifs, mais avec un côté sensationnaliste : « C’est gore ? », en essayant de me faire dire à quel point c’était horrible. Et j’ai aussi reçu beaucoup de soutien : des voisins m’ont fait à manger, des gens ont déposé de la nourriture dans ma boîte aux lettres, on m’a offert un mois de loyer, etc.
Les applaudissements à 21h, ça me saoule. Des collègues diraient autre chose, mais moi je trouve qu’on en parle comme si nous étions les seul·le·s à travailler et, en fait, ce n’est pas vrai du tout. Il y a une espèce de survisibilisation. Nous, c’est notre boulot ; d’habitude nous faisons ça dans la vie. Soit les gens nous applaudissent tous les soirs, avec ou sans Covid-19, soit pas… Cette héroïsation du personnel soignant m’énerve. Comme si les gens n’avaient pas accepté les coupes budgétaires qui ont affecté notre travail. Pour moi, les gens qui applaudissent, je le prends un peu comme : « On vous a bien mis dans la merde et vous y allez quand même, bande de bouffons. Bravo! » Et je me dis, avec rancœur, que j’aurais envie que cette situation soit portée différemment et que les personnes qui veulent applaudir, applaudissent tout le monde ! Il y a trop de travailleur·euse·s qui ont continué et dont on a jamais parlé. Et elles et ils sont aussi indispensables que moi. Ça m’énerve.
Je pense aux gars des chantiers et aux livreur·euse·s des magasins qui sont passé·e·s en mode livraison, avec tout le monde qui s’est mis à commander sur internet. Elles et ils ont continué à arpenter les rues et à faire le tour de tous les domiciles pour livrer des machines Nespresso. Les nettoyeur·se·s, les conducteur·trice·s de transports publics – les contrôleurs ont disparu, ça, ça m’a quand même fait très plaisir. Les chauffeur·se·s de bus se sont baladé·e·s dans des incubateurs géants en continu. En fait, plein de gens. J’ai envie de dire: « Vous êtes choux de nous applaudir, mais moi je suis à l’hôpital, je suis protégée, je suis équipée de la tête au pied. Par contre, pas celles et ceux qui ont continué de travailler dans des endroits essentiels sans protection ! »
J’ai bien vu comment dans certains endroits en France, les femmes étaient aux soins avec des patient·e·s qui leur postillonnaient du Covid dessus. Elles n’avaient pas de protection. Et on leur disait : « Sur votre temps libre, vous allez faire un bandana avec votre chemise. » Alors là, je perçois davantage la bravoure. Quant à moi, je suis bien payée, bien équipée et je fais le travail pour lequel j’ai été formée. La métaphore des héros et héroïnes ne me parle pas du tout ! Aller travailler a été pour moi un outil de survie mentale. J’ai eu de la chance, je n’étais pas obligée de me confiner, je pouvais aller bosser. Je me suis sentie privilégiée. Je n’y suis pas allée pour soutenir la nation, mais pour faire quelque chose, plutôt que déprimer chez moi, sans plus aucun rythme. Je m’occupe des gens et j’aime ce travail. Les gens ne vont pas bien et, pour moi, ça fait du sens d’être là. J’ai participé à des moments aussi très beaux, de solidarité et d’échanges ; par exemple, lorsque je me suis retrouvée à encadrer des nouvelles infirmières dont c’était le premier poste.
Personnellement, le bien-être des individus que je côtoie me touche fort, les injustices qu’ils subissent également. Leur parcours de vie et leurs réactions émotionnelles m’intéressent. C’est peut-être un regard qui sacralise trop la vie, mais ça me tient fondamentalement à cœur que les gens soient heureux. J’aime parler aux gens et rigoler avec elles et eux. J’aime savoir comment elles et ils évoluent dans le monde. J’aime quand elles et ils me racontent leur vie, leur premier baiser, ce qu’elles et ils font dans leurs loisirs ; des choses cons me passionnent. Et j’aime aussi beaucoup l’aspect biologique, le fonctionnement du corps. Le plus intéressant, c’est comment intégrer cela dans la réalité quotidienne des gens en fonction d’où ils viennent, de leur vécu, de leurs aspirations. Je trouve ça captivant. Infirmière, je crois que c’est un des meilleurs métiers que tu puisses faire si tu aimes cela. Tu le fais tout en étant dans le care, le « prendre soin ». Tu as une prise en charge très variée, globale, à la croisée du social, de l’alimentation, de la santé physique et psychique, des questions de classes, … Nous sommes au centre de plein de réflexions et d’actions sur la vie des gens. Nous pouvons vraiment renforcer les gens.
Classe sociale et soins
De manière générale dans la santé, la classe sociale des patient·e·s a une incidence sur leur prise en charge, à travers la manière dont on les prend au sérieux ou pas et les préjugés qu’on porte sur elles et eux. C’est un biais important de l’accès aux soins. Quand tu arrives aux Urgences, tu ne vas pas être écouté·e pareillement selon d’où tu viens ou comment tu es habillé·e. Tout le monde a des préjugés, des constructions sociales et des réflexes de pensée qui sont délétères pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le cadre dominant. Mais avec le Covid, c’est tellement la merde, il y a tellement d’inconnues… Comme personne ne comprend rien à ce virus, il est plus difficile de jouer sur ton statut et d’obtenir des soins de meilleure qualité, par un·e médecin qui aurait plus d’expérience. Je trouve que ça remet les pendules à l’heure.
Tu as une qualité des soins de merde, par manque de connaissances du Covid, mais la même pour tou·te·s lorsque tu es pris·e en charge. Dans notre unité, les patient·e·s arrivent déjà assez mal en point. Personne ne va dire : « Il exagère ! » Certains paramètres nous poussent à ne pas remettre en question les récits des patient·e·s. J’ai passé une journée entière avec un monsieur venant d’un pays lointain et parlant une langue inconnue. Je n’ai eu aucun commentaire sur ce monsieur, alors que d’habitude on entend des « il me saoule » ou « on ne comprend rien ». Les soignant·e·s ont imprimé des petites images pour essayer de communiquer avec lui. On retourne aux soins et à pourquoi on exerce ce métier. Je n’aime pas ce mot mais : par humanisme. Les personnes que nous prenons en charge sont redevenues des êtres humains, avant d’être philippin·e·s ou érythréen·ne·s.
Charge de travail et stress
En terme de charge de travail, je ne trouve pas que ce soit pire que d’habitude, même si les conditions de travail d’une infirmière ne sont vraiment pas extraordinaires. Mais ça n’a rien à voir avec comment d’autres personnels de santé se débattent ailleurs en Europe. En comparaison, je n’ai rien à redire. Après, en terme de charge de travail, cela signifie une galère vis-à-vis de laquelle nous sommes blasé·e·s. Le système est organisé en « shifts » : des périodes horaires sur lesquelles nous travaillons et que nous validons en cochant des soins. Nous avons une « check-list » de gestes à faire pendant notre période de travail. Les soins sont organisés comme ça. Avec le Covid, les gestes à cocher sont plus techniques et ont plus de répercutions que d’habitude si tu les fais pas ou mal. C’est assez stressant, mais on nous compte plus de temps pour les faire.
Les conditions de travail habituelles dépendent vraiment de ces cases à cocher, du nombre d’actes infirmiers à faire avant de passer le relais à nos collègues. Sinon elles et ils devront se taper les leurs, plus celles que tu n’as pas réussi à accomplir. Ça, ce n’est vraiment pas cool, parce que tu cours déjà toujours après le temps pour remplir toutes tes petites cases. Là, c’était pareil, sauf que les cases n’étaient pas les mêmes. Nous stressions parce qu’il s’agissait d’actes auxquels nous n’étions pas habitué·e·s et qui prenaient plus de temps, mais l’exigence des coches restait la même. C’est un travail à la tâche, à la performance.
« La phrase : « aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire », ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas ce qui se passe. »
Je n’avais aucune idée de ce qui se passait ailleurs. Je n’étais en contact qu’avec l’hôpital et avec ma chambre. Je me levais vers 5h30 et je rentrais chez moi vers 20h ; je dormais et je me levais. Les jours de repos, je dormais. J’étais très fatiguée. Les politicien·ne·s ont décidé – on les adore – que les lois du travail ne s’appliquaient plus à nous. Nous n’avions plus de limitation d’horaire de travail. Certain·e·s se retrouvaient à faire le nombre d’heures prévues et d’autres 60 heures par semaines. Les 12 heures étaient plutôt respectées. À partir du moment où tu les avais faits, si une demi-heure débordait, c’était en général à cause des transmissions. Ça arrive hors Covid aussi.
L’accumulation des journées de travail de 12 heures te crève, en vrai. Quand tu as fait cinq jours de 12 heures dans une semaine, tu ne sais plus comment tu t’appelles ! On vit dans un monde capitaliste, et cela se sent. J’ai arrêté d’écouter ce qui se disait, car ça n’avait vraiment aucun rapport avec la réalité de ce que nous vivions sur le terrain. Pour moi, à travers toutes les décisions qui sont prises et comment le monde s’organise en ce moment, on tient compte uniquement de la santé économique et non pas de la santé de la population. C’est là que l’énergie est mise et investie, en dehors de l’hôpital. L’hôpital, encore heureux qu’il réagisse comme il l’a fait, car il existe pour gérer des situations comme celle-là.
Concernant le reste des institutions, on va investir dans la rentabilité et faire en sorte que l’économie continue de tourner, que le capitalisme gagne. Les décisions ne sont pas prise en fonction de la maladie. Déconfiner maintenant alors que nous, nous observions seulement que la tendance était en train de s’inverser… C’est comme quand les gens ont une angine, au bout de deux jours, ils n’ont plus mal à la gorge et se disent : « Ah c’est bon, c’est fini, j’arrête les antibios. » Ça ne marche pas comme ça ! Mais ça ne compte pas de toute façon. Seule compte la puissance économique de la Suisse ; les décisions sont prises en fonction. La phrase : « aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire », ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas ce qui se passe.
Ce regard sur la situation était partagé parmi mes collègues, même s’il outrait peut-être moins les autres que moi. Pour les collègues également, les décisions politiques étaient en décalage total avec le rythme auquel nous avancions. Il y avait une inertie monstrueuse. On n’a pas eu de vrai confinement. À l’hôpital, nous avons pu observer les effets des mesures gouvernementales, un mois après qu’elles ont été instaurées. Mais il était évident pour tout le monde que les décisions de ré-ouverture avait été prises 10 jours avant d’être annoncées, à un moment où nous recevions encore beaucoup de gens. Les décisions ne sont pas prises en lien avec nos expériences à l’hôpital, où nous avons une vision précise du flux. Les politicien·e·s et nous, nous ne sommes pas aux mêmes endroits.
À l’hôpital, les médecins avaient prévu une catastrophe d’une grande ampleur qui n’a finalement pas eu lieu. J’ai l’impression que, même si on se retrouvait face à un nouveau pic, ça devrait aller. Les médecins avaient prévu de gérer une situation beaucoup plus grave. Et tant mieux que ça ne soit pas arrivé ! Si on l’avait vécu, on aurait été préparé·e·s. Mais là, c’était un luxe de pouvoir râler et dire : « Ah, ils en ont fait un peu trop… ». C’était génial en fait. Il y aura une nouvelle vague, c’est sûr. Après, que ça va nous « mettre la misère », à part économiquement, je ne le pense pas. D’autres gens vont mourir, mais sanitairement, je pense que la crise pourra être gérée. Par contre, il y aura un impact sur l’accès aux soins de toutes les personnes qui n’ont pas de papiers, avec les questions de légalité et d’illégalité sur le territoire, sur comment elles osent aller consulter. À part pour ces personnes-là, pour les autres, ça devrait aller.
« La pression économique de performance des soins était moins omniprésente. »
D’habitude, il y a la rentabilité. Il faut faire circuler les patient·e·s. Il faut faire circuler le flux. Il faut que les lits se vident et se remplissent, se vident et se remplissent. Et du coup, on est surtout dans le protocole et moins dans ce qui pour moi fait tout l’intérêt des soins : l’adaptation des soins à l’individu, à sa vie, à sa réalité et comment ceux-ci s’inscrivent dans un contexte socio-économique. Cette crise est un gouffre à argent. 150 personnes ont été embauchées du jour au lendemain. Là, il n’était pas question de rentabilité. Là, c’était le service public. Et ça s’est ressenti. La pression économique de performance des soins était moins omniprésente. Il y avait une meilleure prise en charge des gens et de leurs besoins. Nous nous retrouvions à faire des choses impossibles en temps normal. Par exemple, d’habitude, on ne va pas trop stimuler une personne qui souffre de démence, à part dans les services faits pour ça. On ne va pas s’entêter à essayer d’avoir une discussion avec elle. On n’a pas le temps ! Alors que là, nous avions du temps, parce que nous avions le bon ratio de collègues, et tant que l’état des patient·e·s le permettait, nous avons pu faire une prise en soins adaptée aux gens. Nous avons eu le temps et c’était bien, ce n’était pas superflu.
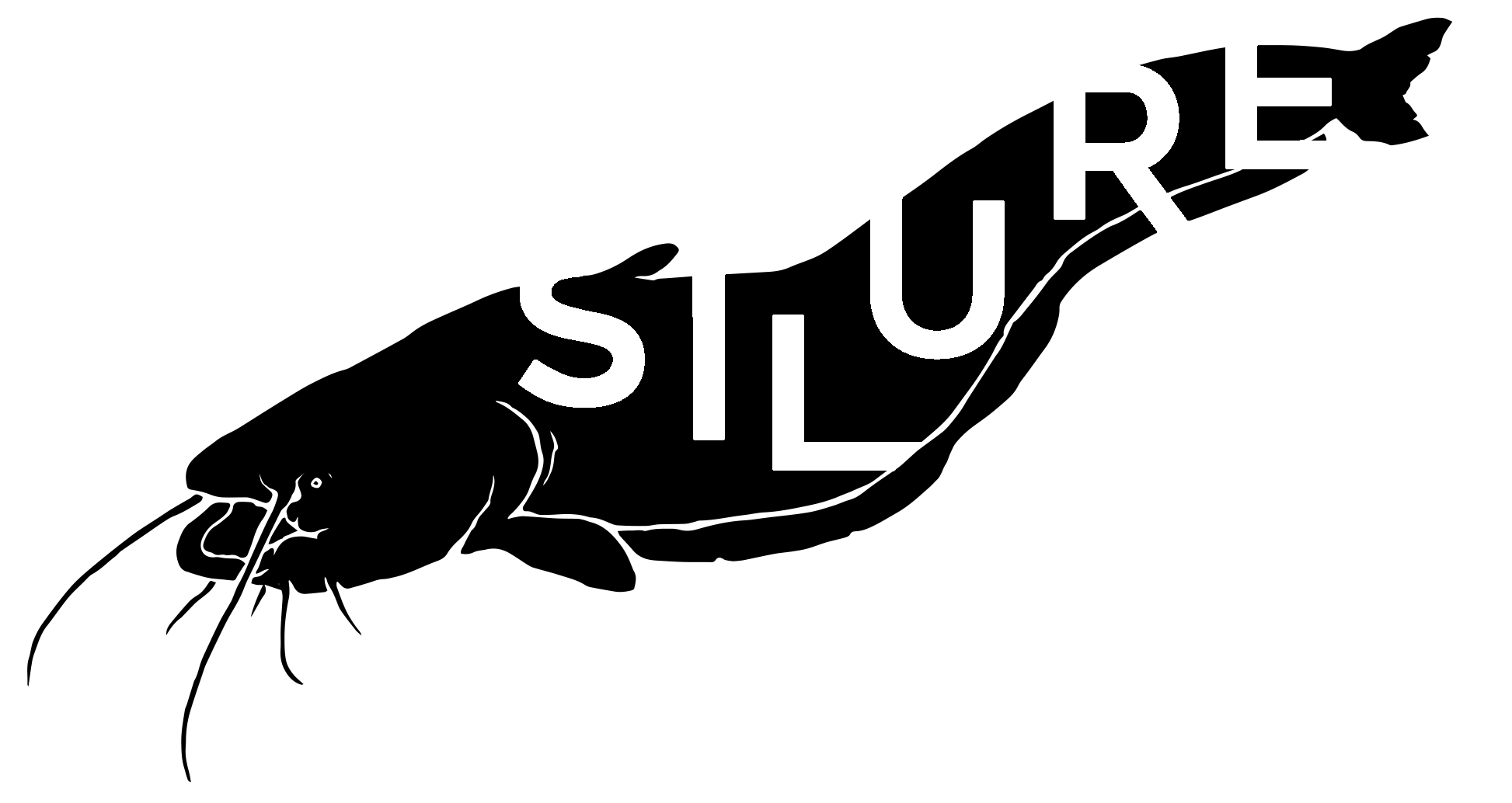





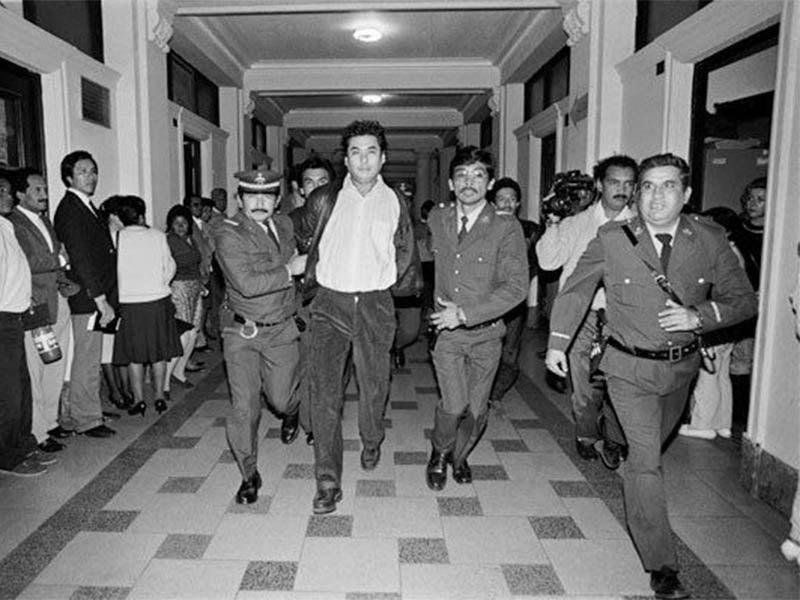

Commentaires récents