
Wallmapu. Prisonniers politiques mapuches au Chili

La pandémie a atteint un niveau mondial. En Araucanie, des voix s’élèvent aussi pour réclamer des mesures de protection derrière les murs des prisons. Aujourd’hui, le peuple mapuche, historiquement criminalisé des deux côtés de la Cordillère des Andes, demande la protection de ceux qui sont privés de leur liberté pour avoir défendu leur territoire ancestral. Depuis les prisons de Temuco et d’Angol, en préventive ou condamnés, ils demandent que leur droit à la vie soit préservé face à la pandémie.
Cet article est le quatrième de la série « criminalisation et punition en prison, sous Covid 19 ». Il a été écrit par Vivian Palmbaum de Marcha Noticias. Il se concentre sur les prisonniers politiques mapuches. Le peuple mapuche vit de part et d’autre de la Cordillère des Andes au Chili et en Argentine. Les communautés de cette région se sont engagées dans des processus de récupération des terres pour reprendre leur territoire ancestral – Wallmapu – aux grands propriétaires. Elles ont été confrontées à une campagne de menaces, de harcèlement, de répression et de violence de la part de l’État, de grands propriétaires terriens et de sociétés multinationales qui cherchent à occuper ce territoire économiquement rentable et stratégiquement important. Souvent, la lutte des Mapuches pour rester sur leurs terres est classée comme du terrorisme. De nombreux dirigeants mapuches ou lonkos, ainsi que des membres de la communauté, ont subi cette répression et plusieurs d’entre eux purgent de longues peines dans des prisons chiliennes.
Le 11 septembre 2018, le Mapuche Lonko Facundo Jones Huala a été extradé d’Argentine vers le Chili. Cela alors que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies avait demandé un sursis à l’extradition pendant que des experts indépendants examinaient le dossier. Ainsi, en se conformant à la demande chilienne et en extradant Huala, l’Argentine a violé le droit international. L’État chilien a accusé le chef mapuche d’avoir allumé un feu dans un lieu habité et d’être en possession d’une arme non conventionnelle. Huala a également été victime de persécution judiciaire en 2015, quand sa communauté a entamé un processus de récupération des terres contre le groupe millionnaire italien Benetton.
« Que le gouvernement ne se trompe pas, les prisonniers politiques mapuches ne sont pas seuls. »
Temuco
Les membres de la famille, les amis et le réseau de soutien de Machi Celestino Córdova (Machi est un leader spirituel dans les communautés mapuches) ont dénoncé le 25 avril le refus du gouvernement de protéger la vie et l’intégrité physique des prisonniers mapuches face à l’avancée rapide du covid-19. Dans ce contexte, la gendarmerie chilienne a laissé entrer un fonctionnaire dans l’institution, dont la situation sanitaire quant au covid-19 était évaluée, afin qu’il puisse rencontrer Facundo Jones Huala et d’autres prisonniers de la prison de Temuco. Selon leur communiqué, deux jours plus tard le Lonko (chef mapuche) a été séparé du reste des prisonniers mapuches. Finalement, les résultats des tests par écouvillonnage effectués sur Facundo Jones Huala sont revenus négatifs et il est resté en isolement préventif pendant 15 jours.
Le Comité pour les prisonniers des peuples indigènes, en Argentine, a publié un communiqué dans lequel il demande à l’État argentin d’entreprendre des actions pour rapatrier Facundo Jones Huala qui est emprisonné au Chili. Dans ce document, ils dénoncent les « actions criminelles du gouvernement de Sebastián Piñera » et appellent à la solidarité internationale face à la situation injuste de discrimination dont souffre le peuple mapuche. Le lonko Facundo Jones Huala a été extradé d’Argentine vers le Chili et condamné avec de faibles preuves, sur la base de suppositions, la création de l’ennemi facilitant ensuite l’appropriation de ses terres. Les terres de la Patagonie, des deux côtés de la frontière, possèdent des richesses naturelles incommensurables : eau, gaz, pétrole, entre autres. L’obstacle à l’exploitation de ces richesses, ce sont les peuples originaires.
Les communautés de plusieurs zones de récupération des terres mapuches se sont unies pour dénoncer le fait que le gouvernement chilien ne suit pas les recommandations des organisations internationales, comme l’ONU et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), pour protéger la vie des populations incarcérées contre le danger auquel les expose la pandémie, en raison des conditions alarmantes dans lesquelles se trouve la population carcérale de la région. Les membres des familles et les réseaux de soutien ont manifesté en ce sens : « La CIDH rappelle aux États que toute personne privée de liberté sous leur juridiction a le droit de recevoir un traitement humain, dans le respect absolu de sa dignité, de ses droits fondamentaux, et surtout de sa vie et de son intégrité personnelle ».
Auparavant, dans un communiqué de la prison de Temuco, les prisonniers politiques mapuches avaient déjà dénoncé le fait qu’à ce jour, les seules personnes qui avaient été libérées grâce à l’excuse de la pandémie étaient « des personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité et des crimes anti-mapuches comme le flic tueur qui a tué (Camilo) Catrillanca et les terribles agents de l’opération Ouragan ». « La vie du peuple mapuche n’a-t-elle pas d’importance ? » demandent-ils. Ils soulignent la décision politique qui les maintient enfermés, alors qu’ils ont rempli les conditions nécessaires pour bénéficier d’une libération permettant d’éviter le danger de la contagion. Ils étendent la demande à tous les prisonniers d’un système pénal qui déborde, comme dans toute la région.
De son côté, Machi Celestino Córdova a repris le 4 mai la grève de la faim qu’il avait suspendue le 20 mars, exigeant le respect de la convention 169 de l’OIT, qui se réfère spécifiquement aux prisonniers indigènes, avec les mêmes demandes de protection.
Angol
Depuis ce territoire, les communautés mapuches en résistance de Malleko ont dénoncé la discrimination dont sont victimes les prisonniers mapuches dans la prison d’Angol, ainsi que les mesures abusives dont ils font l’objet. Le 4 mai, les prisonniers mapuches de la prison d’Angol ont également entamé une grève de la faim pour exiger la mise en place de mesures de protection contre le danger de covid-19 dans ce contexte. Ils ont revendiqué la nécessité de « libérer les prisonniers politiques mapuches ou de passer à une mesure alternative à la prison, comme le stipule la Convention 169 de l’OIT, articles 8, 9 et 10, et compte tenu également de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes ». Ils demandent également la restitution des terres et la démilitarisation des territoires où sont toujours protégés les intérêts économiques des sociétés transnationales.
Dans le communiqué, ils appellent les différentes communautés en résistance à être attentives à l’injustice du gouvernement chilien à l’égard des prisonniers politiques mapuches de la prison d’Angol : « Que le gouvernement ne se trompe pas, les prisonniers politiques mapuches ne sont pas seuls ».
Droits des peuples
La situation a également obligé la CIDH à publier un communiqué le 8 mai, exhortant les gouvernements à adopter des mesures de protection pour les populations indigènes face à la pandémie. La Commission met en garde sur la situation de « vulnérabilité particulière des populations indigènes, en particulier celles qui sont volontairement isolées ». Elle rappelle la violation historique des droits qui pèse sur ces populations et qui se traduit par une situation d’extrême pauvreté par rapport au reste de la population non indigène.
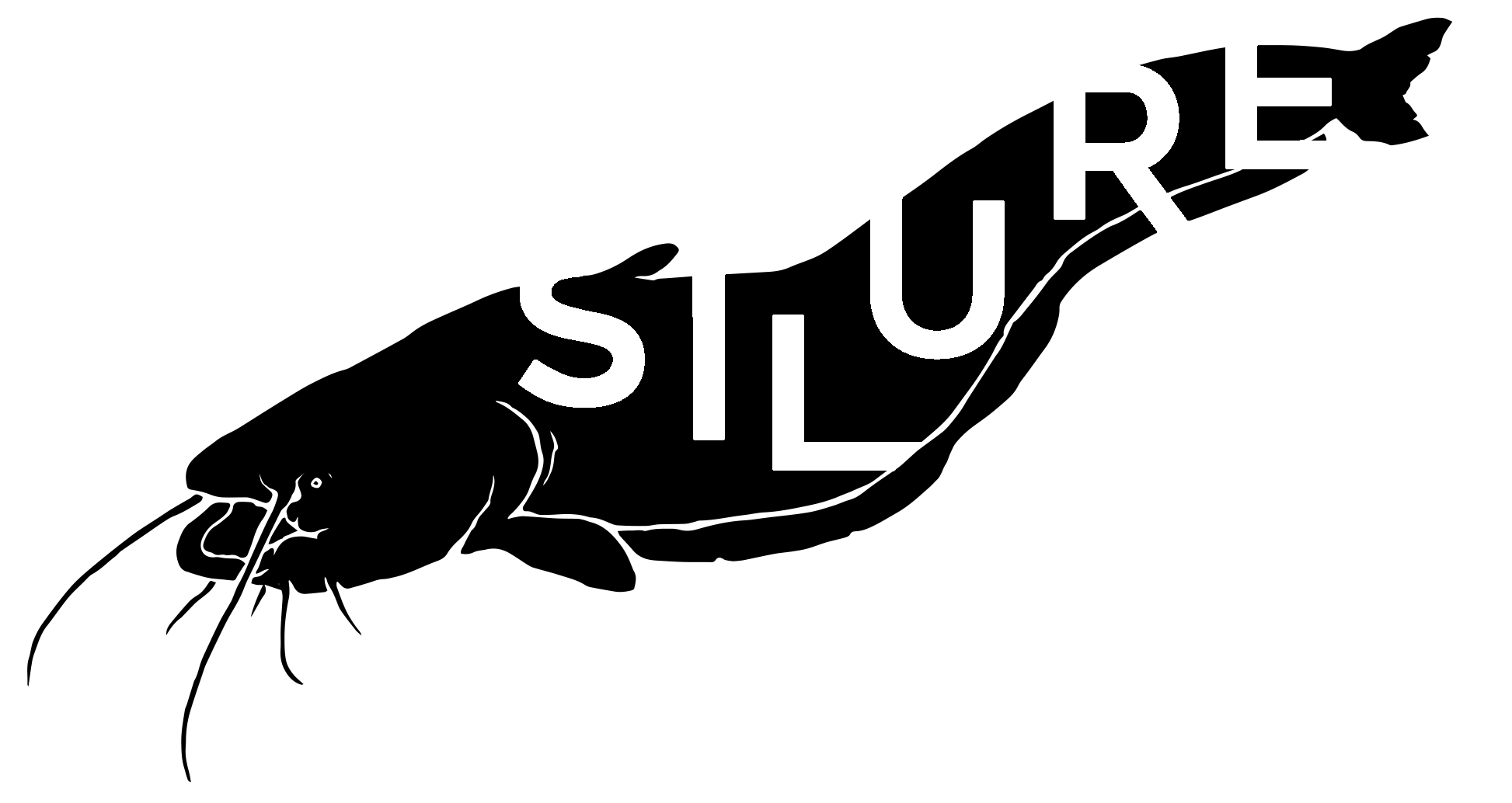










Commentaires récents