
Tout a commencé à l’occupation du Grütli. Le 13 janvier 2020, quand j’ai appris qu’il y avait cette occupation, j’y suis allée et j’ai rencontré des MNA, des mineurs non accompagnés qui devraient être pris en charge par le SPMI, le Service de protection des mineurs. J’ai été extrêmement frappée par la mauvaise santé de ces jeunes. Ils montraient vraiment des signes de détresse terrible. Je découvrais que plusieurs d’entre eux avaient fait des tentatives de suicide. Certains avaient des attelles qui masquaient les blessures volontaires faites avec une lame. On sentait un désespoir et une tristesse qui n’étaient pas nommés. Mais les jeunes étaient là, malgré toute la difficulté que représentait leur situation.
Témoignage sur l’accès à la santé des jeunes MNA recueilli par téléphone le 19 mars 2020.
« Parmi les professionnels, très peu percevaient que ces jeunes souffraient. »
Ils m’ont identifiée comme soignante grâce à la première occupation, parce qu’un des hommes présent à cette époque leur a parlé, en arabe. Je ne sais pas ce qu’il leur a raconté. Mais tout de suite après, le jour même, ils sont venus vers moi pour me demander soit des médicaments, soit de l’aide. Avec par moment, des cris de désespoirs, comme ceux d’un jeune asthmatique, par exemple. Il y avait des problèmes d’infection urinaire, d’asthme, de gale, d’épilepsie et une fracture de la racine des dents ; et beaucoup de petits problèmes, comme des maux de tête, de dents ou autres.
Je dois dire que cette occupation du Grütli a été beaucoup plus éprouvante pour moi que la précédente, il y a 4 ans. Parce que les ados, ce sont vraiment des ados quoi. On peut les aider à obtenir les médicaments dont ils ont besoin. Comme le petit qui avait de l’asthme, il était tellement soulagé qu’il s’est jeté dans mes bras et qu’il a pleuré. Il a pleuré comme un enfant. Pourquoi ? Je ne l’ai jamais su. Il n’a jamais pu parler. C’est très violent cette histoire. Ce petit-là, il a disparu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
A partir de ce moment, j’en ai amené quelques uns à l’hôpital. Très vite, je me suis aperçue que ces jeunes faisaient peur. Une femme médecin m’a confié qu’elle avait peur d’eux. Une infirmière m’a aussi demandé comment je faisais. Quand une médecin vient exprimer cette crainte, elle le fait gentiment, même si elle a peur. Mais je trouve plus honnête de le dire, que d’être agressive ou de les envoyer paître. Ce n’est pas facile pour les soignants s’ils ont peur…
De plus, ces jeunes sont souvent catégorisés comme étant des menteurs. On leur oppose tout de suite qu’ils sont plus vieux que ce qu’ils affirment ; alors que certains ont des papiers quand même, où ils peuvent prouver qu’ils ont 15 ans, 17 ans. Et le problème n’est pas leur âge !
On se trouve avec certains jeunes qui ont certainement des problématiques d’ados. L’un dit qu’il ne sait pas quoi faire, qu’il aimerait travailler comme ferblantier, mais il n’est pas reconnu. Il n’a pas de débouché pour trouver du travail, une école ou un apprentissage. C’est assez désespérant.
« Quelle vision on a des ces jeunes ? Qu’est-ce qu’on leur offre ? On leur montre la peur qu’ils inspirent et ils le ressentent très fort. »
Enfin, ils sont souvent taxés de polytoxicomanes. Alors que si ceux que j’ai rencontrés fument parfois des joints, tous ne prennent pas des drogues dures. Ça devient très compliqué pour eux de faire valoir qui ils sont. On ne les respecte pas. C’est faire fi de leur souffrance à ces jeunes, de les mettre uniquement dans la case « toxicomanie ». Un petit gars avec qui j’étais en route pour l’hôpital a croisé des connaissances qui lui ont proposé de fumer un joint. Il m’a interrogée : « Je peux ? ». « Si tu me le demandes, je vais te répondre non ; mais tu es assez grand, tu fais ce que tu veux », j’ai répondu. Il m’a dit : « T’as raison. » Il est resté avec moi ne m’a pas quittée jusqu’au soir. Donc je sais qu’il n’a pas fumé. On prétend quand même qu’il est toxicomane. Il confie que quand il fume un joint le soir ou par moment, ça le détend. Ils ont de telles vies ! Je ne suis pas en train de nier que de la drogue circule, mais je peux comprendre que quand ils n’ont pas à manger, ça calme aussi. A part le shit, le petit gars m’a dit qu’il avait arrêté et l’alcool et les drogues dures depuis longtemps. Et lui, il ne prenait pas de médicaments.
Quelle vision on a des ces jeunes ? Qu’est-ce qu’on leur offre ? On leur montre la peur qu’ils inspirent et ils le ressentent très fort. Un événement illustre cela : lorsque les jeunes MNA ont été accompagnés au SPMI à la fin de l’occupation du Grütli, des voitures de police ont tout de suite rappliqué avec leur sirène autour du bâtiment. J’ai été surprise, d’autant que la Ville avait promis de ne pas appeler la police, à moins d’événements graves. Et les jeunes s’étaient tranquillisés. Il faut savoir qu’ils craignent la police, et aussi les gens qui ont peur d’eux…
Après l’occupation
Un matin à 8h, je suis allée chercher un jeune à l’hôtel où il avait été logé par le SPMI. Un petit jeune qui avait la gale. Je lui ai dit : « Viens, lève-toi, il faut qu’on aille à l’hôpital, aux urgences. » C’était vraiment l’ado qui répondait : « Mais… je veux dormir ! » « Non allez, tu te lèves.. », j’ai insisté. « Non, après! », il a encore essayé. Puis, il s’est levé et je lui ai demandé : « Tu prends un petit déjeuner ? » Il a dit : « Non ». Je lui ai conseillé de se nourrir : « Écoute on sera à l’hôpital à 8h30, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer pour qu’on voie un médecin, pour qu’on puisse te donner un traitement. Mange quelque chose. » Alors il a pris une banane. J’ai pensé : c’est toujours ça dans son estomac. Nous sommes partis et le réceptionniste de l’hôtel nous a rattrapés : « Ah non, non, non, il n’a pas droit à un fruit ! S’il veut un fruit, il doit payer ! Il faut qu’il paye sa banane 1.-. » Finalement, le gars a lâché : « Bon, ça ira pour cette fois. » Et nous avons pu partir avec la banane.
Effectivement, nous sommes arrivés à l’hôpital à 8h30 et en sommes sortis à 18h. Parce qu’on te donne un ticket et qu’il faut attendre ton tour ; il y a tellement de monde à l’hôpital. On lui a diagnostiqué la gale, comme à plusieurs de ces jeunes. D’ailleurs, j’ai constaté qu’il y avait un problème de santé publique. Ce qui aurait dû être fait ? Ceux ayant la gale auraient dû pouvoir rester à l’hôtel où ils dormaient pendant le traitement ; ensuite, une fois traités, on aurait pu éventuellement les changer de lieux et désinfecter les chambres. Au lieu de cela, ils ont dû aller dormir dans des sleep-in. Après avoir été diagnostiqués, le SPMI en a sorti certains de l’hôtel pour les mettre dans des dortoirs communs ! Tu augmentes le risque de transmission en agissant de cette manière. C’est une maladie transmissible, par contact. Le traitement devrait se passer ainsi : tu prends tes pilules le matin ; 8h après tu te douches, tu laves tes cheveux, tout ton corps et ton linge, et tu reprends quatre pilules. Donc il faut des produits pour se nettoyer, puis mettre des habits qui n’ont pas été en contact avec la maladie. Les habits propres, nous les avons obtenus grâce à un bon donné par le CSP.
« Qu’est-ce qu’ils attendent en venant ici ? J’ai vu des jeunes détruits. Est-ce qu’ils étaient déjà détruits dans leur pays ? Je ne sais pas. »
Un jeune a fait des chutes. Il disait qu’il était épileptique, qu’au pays il prenait des médicaments contre l’épilepsie. Depuis mi-janvier, il n’avait toujours pas été diagnostiqué. On ne savait pas. Il devait aller consulter dans deux semaines en neurologie. Malheureusement, j’ai peur qu’entre-temps on l’aie perdu. Je ne l’ai pas revu. Il y a une lenteur impressionnante dans les soins pour cette population. La médecine est fractionnée. Quand tu amènes quelqu’un comme ça aux urgences, on va te dire : « C’est possible que ce soit une gale, mais peut-être pas. Il faut donc revenir la semaine prochaine à telle heure, tel jour, à la permanence de dermatologie pour confirmer le diagnostic. » Tu as déjà perdu une semaine. Ils ont des doutes sur le diagnostic. Il y a toute une machine, des directives, une médecine parcellaire… Ce ne sont pas des médecins généralistes, ils procèdent par spécialité. Ensuite seulement, on te donnera les médicaments et vu les conditions dans lesquelles vivent ces jeunes… Plusieurs d’entre eux, on ne sait pas s’ils ont pu soigner leur gale.
J’ai trouvé que parmi les professionnels, très peu percevaient que ces jeunes souffraient. Quand ils sont agressifs, c’est souvent parce qu’ils ont faim ! Et comme ils ne reçoivent rien à manger… En même temps, moi je les trouve assez passifs ; de temps à autre, il y en a un qui pète les plombs mais très vite, il se calme. Les problèmes de santé, la nourriture en insuffisance, les liens avec ces jeunes ne sont pas assez discutés dans le milieu médico-social. On évoque le fait que ce sont des Algériens. C’est vrai… Mais pourquoi ? Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Qu’est-ce qui se passe… Certains dorment dans des salons lavoir et d’autres dans des sleep-in. Ils ne se sentent pas bien ; ils ont peur la nuit, parce qu’il y a parfois des violences. Ils ne se sentent pas en sécurité. Parlons de leurs besoins : des lieux où dormir mais aussi où vivre, une sécurité alimentaire, des soins et être scolarisés ; eux, ils en causent tout le temps de l’école. Je pense qu’ils auraient besoin d’avoir un foyer, de pouvoir raconter leur histoire.
Qu’est-ce qu’ils attendent en venant ici ? J’ai vu des jeunes détruits. Est-ce qu’ils étaient déjà détruits dans leur pays ? Je ne sais pas. L’un d’eux m’a expliqué qu’il n’avait plus peur de rien depuis qu’il a fait la traversée de la Méditerranée dans un petit bateau.
Il y en a qui parlent très mal le français, parce qu’ils ont vécu dans la campagne en Algérie et ne sont pas allés à l’école. Ils sont démunis. Il faut maîtriser la langue pour se faire comprendre et se débrouiller. Les médecins leur prescrivent des antibiotiques, par exemple, sans expliquer où ils peuvent les obtenir. Ces jeunes, qui sont des mineurs non accompagnés, n’ont pas d’adresse, pas d’argent, pas d’assurance maladie. Le médecin doit mettre un signe sur l’ordonnance, les envoyer à la pharmacie du cœur qui se trouve dans un autre bâtiment de l’hôpital. Là, une infirmière leur donne le médicament, mais si l’hôpital ne l’a pas, il faut aller à la pharmacie Bedat, en face de la rue Voltaire, pendant les heures d’ouverture. Lorsqu’on les accompagne dans les différentes phases, ils réussissent à obtenir les médicaments. Mais beaucoup de jeunes, qui vont seuls à l’hôpital, en sortent seulement avec des ordonnances. Certains disent qu’ils en ont marre, ils sont découragés et j’en ai vu plusieurs qui n’arrivaient pas à obtenir de traitement. Mon expérience est que si on ne les accompagne pas, on n’arrive pas toujours à les soigner, ni même à comprendre ce qui leur arrive.
« Nous avons signalé le problème au SPMI : vu son état dentaire, il ne pouvait pas manger de sandwich. On nous a répondu que son certificat médical était échu, mais que de toute façon il recevait des repas hachés. »
Il y a aussi ces phrases que j’ai entendues : « Si vous croyez que votre malheur m’intéresse, vous vous trompez ! », prononcées par des gens qui se prétendent professionnels, qui ont une mission de santé. Parfois, à l’hôpital, il m’est arrivé de demander si le médecin ne pouvait pas mettre directement le tampon de la pharmacie du cœur permettant d’obtenir ainsi les médicaments gratuitement, et qu’on me réponde : « Vous n’avez qu’à les payer vous, les médicaments ! » Je sais pourtant qu’ils y ont droit… Je suis têtue.
Par contre, il y a des services où le personnel est sensibilisé à cette problématique comme la CAMSCO où, avec toutes leurs difficultés, les patients sans statut légal sont reçus par des infirmières et des docteurs qui les écoutent. Et ça change beaucoup la prise en charge. La difficulté à la CAMSCO est qu’ils prennent seulement 30 personnes par jour. Tu dois aussi attendre. L’infirmière fait un pré-diagnostic et soit ils peuvent te soigner sur place, soit ils t’envoient à l’hôpital. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de respect, par rapport au personnel soignant. Du respect et un bon accueil. Certains parmi les professionnels sont nerveux, c’est normal, mais ils n’instaurent pas tout de suite un rapport de force. Ce respect semble aussi insufflé par le médecin chef. Les soignants peuvent peut-être exprimer quand ils en ont marre. De plus, des analyses se font : si une situation avec des jeunes se révèle difficile, c’est parce que ces derniers souffrent et non pas parce que ce sont des voleurs, des profiteurs, des toxicos. Ils pratiquent une médecine plus humaine.
Depuis que le coronavirus s’est déclaré
Il y a quelques jours, je me suis inquiétée pour un jeune qui a les dents cassées suite à une agression subie début janvier 2020. Je l’ai appelé vers 23h. Il m’a dit qu’il avait faim, qu’il n’avait pas mangé. J’ai eu de la peine à déterminer depuis quand ? Depuis le matin de bonne heure, depuis le petit déjeuner à l’hôtel où il est logé. Je me suis renseignée sur les directives, parce qu’il y en a toujours de nouvelles. On m’a affirmé qu’ils avaient droit au petit-déjeuner, ainsi qu’à deux sandwichs par jour pendant la semaine et 30.- de bons Migros le week-end ; je ne sais pas ce qu’on peut faire avec si peu ! Mais ce sont les nouvelles normes parce qu’avant, ils avaient seulement les petits-déjeuners. A 23h, il n’avait quand même pas mangé. Le petit gars m’a dit qu’il avait faim et je n’aurais pas supporté de lui répondre : « On verra demain ! » J’avais justement acheté pour lui des lasagnes et des boissons protéinées en pensant : quand il ne peut pas manger, au moins qu’il ait ça. Je les lui ai apportées à l’hôtel.
Nous avons signalé le problème au SPMI : vu son état dentaire, il ne pouvait pas manger de sandwich. On nous a répondu que son certificat médical était échu, mais que de toute façon il recevait des repas hachés. Alors nous lui avons demandé de photographier son repas et à midi, il a effectivement reçu des nouilles qu’il pouvait avaler, mais le soir…. à nouveau un sandwich ! Donc l’observation par le SMPI de leur situation est faite du bout des lèvres… On sent le mépris ! Évidemment, on va te rétorquer tout de suite qu’il n’a pas exprimé correctement sa demande. Et comme il y a un problème de langue avec lui – parce qu’il ne parle pas le français – c’est un peu plus difficile. Finalement, c’est un médecin d’une association qui est intervenu en faveur de ce jeune.
Actuellement, des lieux d’accueil de nuit s’ouvrent à cause du coronavirus, mais pas parce que la situation des gens est problématique. C’est pour lutter contre la contamination… Ça provoque des situations dramatiques, car ces lieux sont ouverts de 21h environ jusqu’à 7h du matin. Et là journée, ils vont où ? Dans la rue ? Il n’ont même plus la ressource de pouvoir se tenir au chaud à Globus, à la Placette ou dans un autre magasin. Tout est fermé à cause de l’épidémie. Alors on les laisse à la rue. Je ne comprends pas.
Le jeune à qui j’ai apporté à manger, à minuit, quand il m’a vue avec la nourriture, il m’a sauté dessus, il m’a pris dans les bras et m’a embrassé le sommet de la tête. Ah ! J’ai réalisé qu’il n’était pas au courant… Ce qui me fait dire qu’on devrait les rassembler et leur donner une information médicale structurée, avec traduction, sur le coronavirus et ce qui se passe actuellement. Je suis sûre que certains ne comprennent pas la situation. Le petit jeune ne sait pas pourquoi on ne doit pas m’embrasser. C’est une population délaissée…
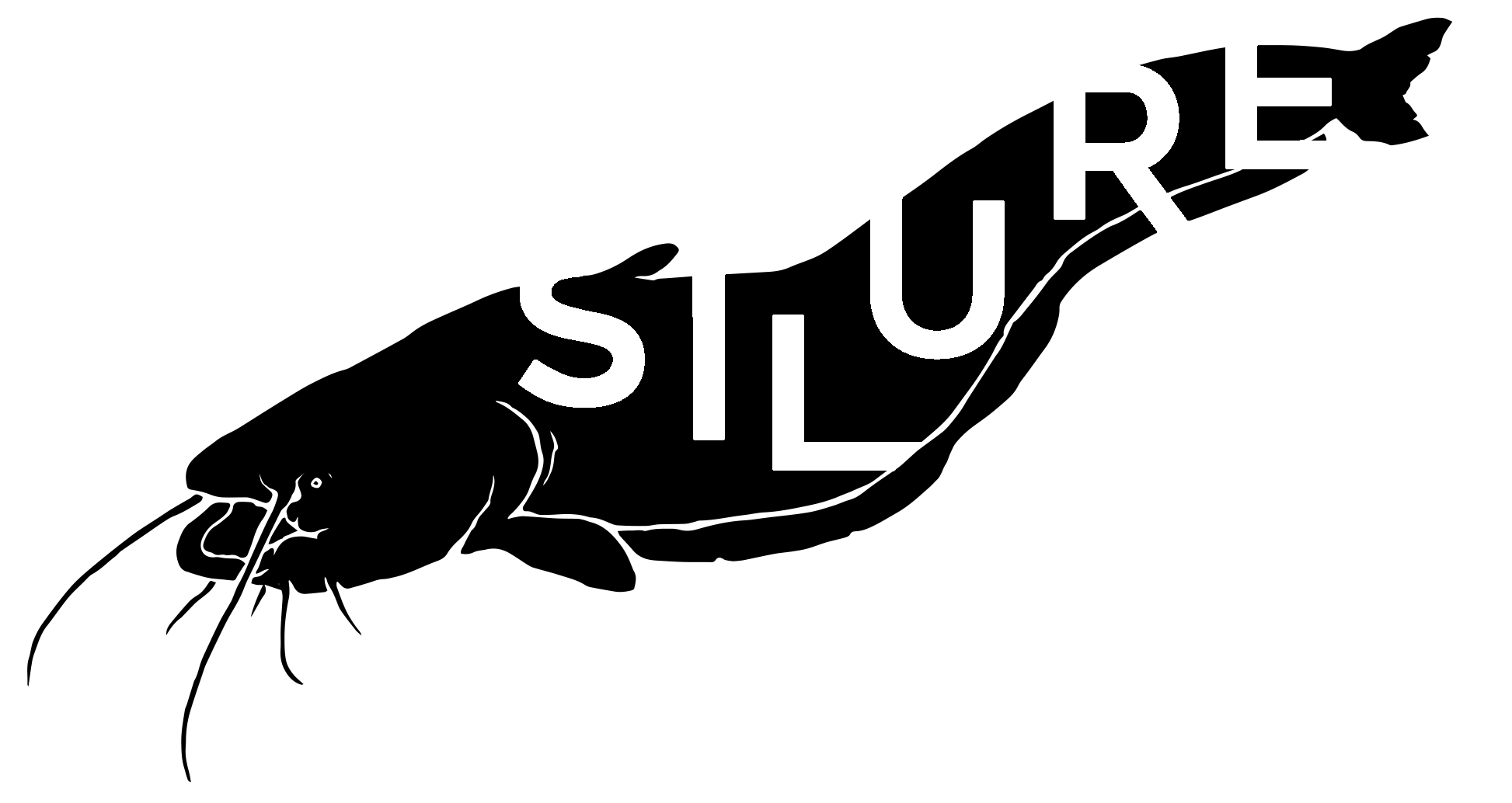
Commentaires récents